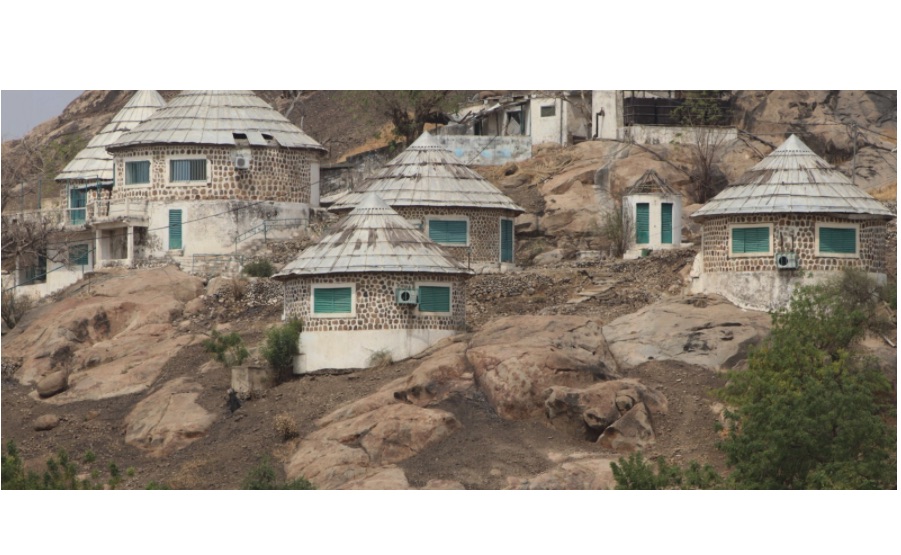. . DEVELOPPEMENT DURABLE . .
Un article de The Conversation (republié sous licence Creative Commons.)
Situé au carrefour de cinq pays de l’Afrique (Centre et Ouest) – Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Niger et Nigeria –, le bassin du Lac Tchad représente une source d’eau importante et vitale partagée plus de 40 millions d’habitants.
Ce bassin abrite une biodiversité ainsi qu’un patrimoine naturel et culturel extrêmement précieux. Des systèmes de productions riches et variés construits sur des usages diversifiés de l’espace, ainsi que des conventions locales anciennes, attestent d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles.

Pêcheurs sur les rives du lac Tchad, en 2015 au nord de N’Djamena (Tchad). PHILIPPE DESMAZES / AFP
Depuis quelques décennies, cet espace est malheureusement en proie à un déséquilibre anthropo-écologique, auquel s’ajoutent les changements climatiques amorcés depuis le début des années 1970 ; ces derniers ont conduit à un assèchement progressif du bassin.
On assiste ainsi à une forte pression, voire un usage concurrentiel des ressources naturelles, doublés depuis plus d’une décennie de conflits armés orchestrés par la secte de Boko Haram. La présence de ce groupe dans le bassin a exacerbé le trafic illégal de bois, le braconnage des espèces protégées et les conflits agropastoraux.
Une situation qui conduit à des migrations importantes de populations.
Des « réserves de biosphère » pour préserver les ressources
Les défis qui se posent actuellement au bassin du Lac Tchad sont de trois ordres.
Un défi sécuritaire pour la restauration de la paix et de la sécurité dans les pays du bassin du Lac Tchad ; un défi écologique, avec la conservation de la biodiversité, la gestion des écosystèmes et leur réhabilitation ; un défi socio-économique, pour la relance des activités agricoles, pastorales et piscicoles, la réduction de la pauvreté, la planification participative et la gouvernance inclusive.
Pour sauvegarder et gérer durablement les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles de cette zone, contribuer à la réduction de la pauvreté et promouvoir la paix, les cinq États du bassin ont décidé d’appliquer le modèle des « réserves de biosphère » transfrontières et des sites du Patrimoine mondial.
C’est dans cette optique que l’Unesco, dans le cadre du projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad (BIOPALT), s’est donnée pour mission d’accompagner les cinq États à la préparation de dossiers de nomination de réserves de biosphère nationales et/ou transfrontières et d’un site de patrimoine mondial transfrontalier dans le bassin.
Une démarche participative
Les différentes concertations – nationale, menée par BIOPALT et régionale, conduite par la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) – ont permis de circonscrire les difficultés majeures du bassin et les attentes des communautés face à ces contraintes.
Pour mener à bien ces initiatives, la démarche participative a été adoptée. Son mode opératoire s’est construit sur quatre composantes principales : connaître, former et renforcer les capacités, réhabiliter et utiliser durablement, gérer et valoriser. Ici, les différentes activités ont été menées en s’appuyant sur des partenaires locaux, mais aussi internationaux.
Le réseau de partenaires du projet est composé de scientifiques (principalement les universités des pays membres de la CBLT, mais aussi d’autres institutions internationales), d’ONG et d’associations. Les travaux conduits sont validés par un conseil scientifique et technique.
Une dizaine d’études sur le bassin du lac Tchad
De 2017 à 2021, treize études ont été réalisées sur la biodiversité, l’hydrologie, la culture et les aspects socio-économiques du bassin. Elles ont permis une meilleure connaissance des risques hydroclimatiques, de la qualité de l’eau, de la diversité biologique et culturelle et enfin de la variabilité et la résilience au climat de cet espace.
(Voir suite sur colonne de droite. . . )
(Cliquez ici pour une version anglaise de cet article..)
What is the relation between the environment and peace
(. . . suite)
Deux outils ont été élaborés : un portail sur la qualité de l’eau dans le bassin du lac Tchad ; une plate-forme de suivi des inondations et des sécheresses. Ces outils permettent le contrôle de la pollution du lac et de ses affluents ainsi que la surveillance des aléas météorologiques.
Quatre ateliers – organisés autour du suivi des inondations et sécheresses, de la surveillance de la qualité de l’eau du lac Tchad et de la mise en place d’un comité PHI Cameroun – auront permis de former 90 experts.
Quelque 2 000 personnes ont également été formées dans le cadre de la gestion pacifique des ressources naturelles, la prévention des conflits et la conservation durable du lac Tchad. Un master et un MOOC ont d’autre part été créés pour aborder la gestion des réserves de biosphère et des sites du patrimoine mondial.
Enfin, une réserve de biosphère a été créée, deux autres ont été proposées ainsi qu’un site transfrontalier du patrimoine mondial, tandis que deux radios communautaires ont été lancées, participant ainsi à la prévention de l’extrémisme violent, la promotion de la paix, la protection de l’environnement et le développement durable.
Sept activités génératrices de revenus portant sur l’apiculture, la pisciculture, le maraîchage agroécologique, la riziculture et l’arboriculture ont été lancées permettant ainsi à 20 000 bénéficiaires de diversifier leurs sources de revenus et de renforcer leur résilience socio-économique face aux impacts du Covid-19.
Trois techniques de restauration écologiques ont également été développées, permettant la réhabilitation des terres dégradées et l’amélioration des compétences communautaires. Des actions de communication (site web, newsletter et événements) visent à faire connaître le projet.
Si 80 % des activités prévues dans le cadre du plan d’action de BIOPALT ont été réalisées, plusieurs points restent aujourd’hui à concrétiser : la finalisation de quatre publications, la réalisation d’une étude bioécologique et socioéconomique à Kalamaloué (Cameroun), la réalisation d’un atelier régional relatif au patrimoine mondial, la finalisation de MOOC sur les réserves de biosphère et le patrimoine mondial.
Restauration écologique et synergie
Plusieurs perspectives se dessinent dans une seconde phase du projet BIOPALT. La restauration écologique est, par exemple, déjà amorcée et vise à rapprocher les différents usagers du lac et promouvoir la paix et le développement. Des activités génératrices de revenus se sont développées et vont permettre d’une part de procurer des revenus substantiels aux acteurs de terrain et de l’autre de renforcer la gestion communautaire pour conserver la biodiversité et réduire la pauvreté.
La transhumance transfrontalière a elle aussi été promue, fondée sur des accords de gestion pacifique des ressources naturelles et de formations (culture de la paix, PVE). Des écoles pastorales mobiles pourront également être envisagées.
Enfin, une synergie d’action entre éducation et alphabétisation se met en place avec d’autres initiatives, à l’image du Projet de renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation (PREAT).
Le projet BIOPALT aura ainsi permis d’obtenir des résultats tangibles dans le domaine de la restauration d’écosystèmes dégradés (mares, plaines dunaires) et la promotion d’activités génératrices de revenus à base d’économie verte.
La formation et le renforcement des capacités sur la gestion pacifique des ressources naturelles, s’appuyant sur « l’approche PCCP » de l’Unesco, a également été développée, tout comme le renforcement de la coopération transfrontalière, de l’intégration régionale et la réalisation de dossiers d’inscription du lac Tchad sur la liste du patrimoine mondial et de création de réserves de biosphère.
Depuis 50 ans, le Programme pour l’homme et la biosphère (MAB) de l’Unesco s’appuie sur l’alliance entre sciences exactes, sciences naturelles et sciences sociales pour trouver des solutions mises en œuvre au cœur de 714 sites naturels d’exception (dans 129 pays) bénéficiant du statut de réserves de biosphère.
Auteurs:
Amadou Boureima, Responsable du Laboratoire d’études et de recherches sur les territoires sahélo-sahariens (LERTESS), Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)
Aristide Comlan Tehou, Chercheur au Laboratoire d’écologie appliquée de la faculté des sciences agronomiques, University d’Abomey-Calavi de Bénin
Daouda Ngom, Professeur titulaire, responsable du Laboratoire d’écologie et d’écohydrologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Mallé Gueye, Enseignant-chercheur, département hydrosciences et environnement, Université Iba Der Thiam de Thiès
![]()