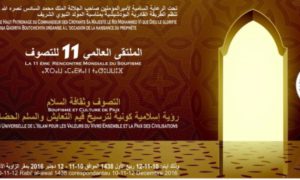. TOLÉRANCE & SOLIDARITÉ .
Un article de Fasozine
A la veille de l’ouverture, le vendredi 3 mars dans la capitale du «pays des Hommes intègres», du symposium international sur le dialogue des religions et des cultures, les deux principaux initiateurs de la rencontre, Filippe Sawadogo* et Lazare Ki-Zerbo*, évoquent dans cet entretien la substance et les temps forts de cet important rendez-vous sur l’éducation à la culture de paix.

Lazare Ki-Zerbo* et Filippe Savadogo*
Fasozine.com: Ouagadougou abrite, du 3 au 7 mars, un symposium international sur le dialogue des religions et des cultures. Est-ce à dire que le dialogue a déserté le forum de ces instances?
Lazare Ki-Zerbo: C’est simplement que la conjoncture aujourd’hui nous invite à remobiliser les mécanismes de dialogue qui existent et qui ont toujours existé. Le peuple burkinabè aime à se dresser pour lutter contre des injustices, des violations. Mais il y a des moments où il faut aussi savoir lutter pour la paix et pour la cohésion nationale. Au regard de l’actualité, vous serez d’accord qu’il faut vraiment qu’on se mobilise pour préserver et anticiper. On ne regardera pas les pays voisins se dégrader, se déliter à cause de ces facteurs-là et rester les bras croisés.
L’initiative vise donc à renforcer la culture de la paix au Burkina Faso et en Afrique. Quels sont, selon vous, les ingrédients de cette culture de paix?
Filippe Savadogo: C’est d’abord la coexistence pacifique, que nous exprimons par le vivre-ensemble. Et cela se traduit par plusieurs mécanismes et ressorts. En questionnant nos valeurs traditionnelles endogènes, nous observons par exemple que les alliances à plaisanterie — que nous appelons «sinagouya» ou «rakiré» — ont permis de tempérer beaucoup de préoccupations lors de certaines crises. De plus, l’Afrique a toujours été un continent où la culture du dialogue fait en permanence partie de l’éducation des jeunes dès la tendre enfance: le respect d’autrui, l’initiation aux valeurs, etc., et nous devons revisiter toutes ces questions-là dans un monde où les défis ne font que se démultiplier.
Enfin, nous avons aussi des apports extérieurs, comme la démocratie, la bonne gouvernance, les relations humaines…, que nous pouvons cultiver en ajoutant de nouvelles dimensions pour construire l’homme africain de notre siècle. Un siècle où la culture devient une adhésion et un apport de plusieurs horizons pour voir vers l’avenir.
Au regard de l’incivisme grandissant, quelle place accordez-vous à l’éducation civique dans ce processus?
Lazare Ki-Zerbo: L’incivisme traduit le fait qu’il y a une rupture du lien intergénérationnel. Notre initiative promeut l’éducation à la paix. Et qui dit éducation à la paix dit commencer dès les classes, dès le plus jeune âge. C’est là que s’apprennent les mécanismes de vivre-ensemble. Il faut donc attaquer les racines de l’incivisme, de l’intolérance, de la violence par une diffusion intensive des principes de cohabitation pacifique et d’acceptation de l’autre. C’est cela les vrais mécanismes. On ne pourra pas résoudre ce problème par la contrainte et la brutalité.
Comment qualifierez-vous le niveau de coexistence entre les différentes religions au Burkina Faso à l’heure actuelle?
Filippe Savadogo: Au Burkina, la reconnaissance du pluralisme religieux est une réalité. Il y a aussi des concertations entre leaders confessionnels. Exemple de l’association faitière que le préside sa majesté le Mogho Naaba et qui initie des recherches de solutions endogènes lorsqu’il y a crise ou malentendu.
Cependant, nous pouvons aussi dire que rien n’est acquis à l’Homme ni à sa descendance. Nous devons donc continuer à cultiver le respect, à comprendre que l’acceptation de la différence est une plus-value. Autant de questions qui montrent que le Burkina, pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, a toujours été un carrefour de recherche de dialogue, de cohésion pacifique, d’accueil, mais aussi d’apprentissage des valeurs positives des autres peuples.
Face au péril extrémiste et terroriste, quelles réponses entend apporter le symposium de Ouagadougou?
Lazare Ki-Zerbo: Le Burkina Faso a en effet la tête dans le grand Sahel ancien — de la boucle du Niger, des grands empires —, mais au sud nous sommes en relation avec les pays côtiers, à l’ouest nous avons cette longue frontière avec le monde mandingue… Je pense que c’est cela qui fait notre richesse. Sans doute un peu comme le Cameroun, le Burkina est aussi une Afrique en miniature et cela fait notre force. Le fait d’avoir été au centre de tous ces grands ensembles nous a permis de tirer parti de ces apports-là pour nous renforcer de l’intérieur.
Le message du symposium, c’est donc: consolidons ce capital, qui est à la fois social, culturel, historique. Un capital qui fait notre richesse et qui peut être un rempart contre les forces de division et de séparation.
(cliquez ici pour une version anglaise de cet article.)
(Voir suite sur colonne de droite. . . )
Question related to this article:
How can different faiths work together for understanding and harmony?
(. . . suite)
Plusieurs personnalités de renom prennent part à cette rencontre. Qu’attendez-vous de leur participation?
Filippe Savadogo: Je crois que la présence d’hommes avertis de la génération des années de l’indépendance, mais aussi de chercheurs et d’universitaires de plusieurs disciplines traduit le fait que nous voulons mettre au centre de ce symposium un cadre de réflexions qui jette les bases d’un plan d’actions pour les années à venir. C’est pour cela que nous pensons d’abord aux grands ensembles de notre région, notamment des personnalités issues des pays membres de la Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Ndlr), du Sahel et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous aurons donc tout un ensemble de hautes personnalités de ces pays qui nous éclaireront de leurs expériences.
Le symposium accueille ainsi, entre autres, un professeur qui vient de Centrafrique, pays qui sort d’une crise, à présent amoindrie, et qui devrait partager son expérience avec les participants. On peut également signaler la présence de l’ancien président de la Transition au Burkina, Michel Kafando, grand témoin de son temps, qui exposera, dès le premier jour du symposium, sur les sources et ressources qui ont permis que la Transition traverse tous les écueils.
Enfin, la présence de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean — qui séjourne au Burkina dans le cadre d’une visite —, nous réconforte dans la dimension du processus de Fès. En effet, la question du dialogue interreligieux et interculturel est une préoccupation à la francophonie. Et lors du dernier sommet, les chefs d’Etat et de gouvernements ont encore encouragé ce type de symposium…
Donc des passerelles à établir entre le «Libres ensemble» de la Francophonie et ce symposium?
Absolument! Dans la mesure où tout conduit à la bonne gouvernance, à la démocratie, mais aussi au vivre-ensemble qui est un segment du «Libres ensemble» avec comme passerelle la jeunesse, les femmes. L’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Ndlr) joue également un rôle non négligeable. L’Unesco a en effet une tradition de recherche de la culture de la paix. Nous avons aussi l’Isesco (Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, Ndlr), avec le docteur Cheikh Boubacar Doukouré qui participe au processus de Bakou, l’Alliance des civilisations et tout un faisceau de personnes qui partageront leurs expériences avec des intervenants venus de toute notre sous-région. La presse n’est pas non plus en reste puisque nous avons un grand volet «Médias et société».
Comment appréciez-vous la récente mesure des autorités béninoises visant à interdire tout regroupement à caractère religieux dans les espaces publics? Est-elle, selon vous, souhaitable? Exportable?
Je pense qu’un dialogue s’est instauré sur cette question avec une pause pour mieux réfléchir. Mais dans une autre dimension, on peut parler de la laïcité de nos Etats et de l’organisation de toutes ces questions. On peut donc y trouver une solution dans le temps, sachant que l’histoire est aussi une projection de l’avenir.
Après celui de Cotonou dont il est le prolongement, à quelles conditions jugerez-vous que le symposium de Ouagadougou n’est pas ne rencontre de plus?
Lazare Ki-Zerbo: Nous avons reçu un mandat du symposium de Cotonou pour tenir la réunion nationale au Burkina parce que nous savons bien que nous avons nos propres spécificités. Nous le ferons avec des acteurs locaux, sachant que très souvent, nos richesses humaines ne sont pas assez valorisées.
Ainsi, et à titre d’exemple, Cheikh Boubacar Doukouré, qui est le président du comité exécutif de l’Isesco (Unesco dans le monde musulman), est aussi le président de l’assemblée des ulemas africains, créée récemment au Maroc. Il s’agit d’une référence en la matière qui prend part à ce symposium, qui s’honore également de la présence de Me Halidou Ouédraogo, président de la Fondation des droits humains. Il y a donc un certain nombre de savoirs et de savoir-faire liés au Burkina qui seront mis en valeur au sein du symposium.
Et tout cela contribuera à la rédaction du plan d’actions…
Tout à fait! Les principaux axes de ce plan pour un processus d’éducation à la paix sortiront des débats. Nous avons déjà quelques idées avec les médias et les chercheurs, afin de disposer d’un plan d’action dont la mise en œuvre sera supervisée par un comité de suivi.
________________________________________
* Filippe Savadogo
Ancien ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication, Filippe Savadogo, 63 ans, est coordinateur d’une plateforme d’expertise francophone dénommée Continental Horizon. Celui qui a également été ambassadeur de son pays, le Burkina Faso, en France, puis représentant permanent de la Francophonie auprès des Nations unies à New York, s’est vu remettre, en 2013, le «Visionary Award» au Festival panafricain du film de Los Angeles. Le diplomate burkinabè est aussi coordinateur pour le Burkina Faso de l’Initiative africaine d’éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel.
* Lazare Ki-Zerbo
Auteur et acteur du mouvement panafricaniste et membre de plusieurs organisations de la société civile — Manifeste pour le liberté-Mouvement des intellectuels, Comité international Joseph Ki-Zerbo pour l’Afrique et sa diaspora (Cijkad), Réseau esprit de Bandung —, Lazare Ki-Zerbo a été conseiller spécial du promoteur de l’Initiative africaine d’éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel, Albert Tévoèdjrè. Diplômé de l’Institut du fédéralisme de fribourg et du Centre autrichien sur la paix et la résolution des conflits de Burg Schaining, il a également été, entre autres, spécialiste de programme à l’Organisation internationale de la francophonie de 2004 à 2014.